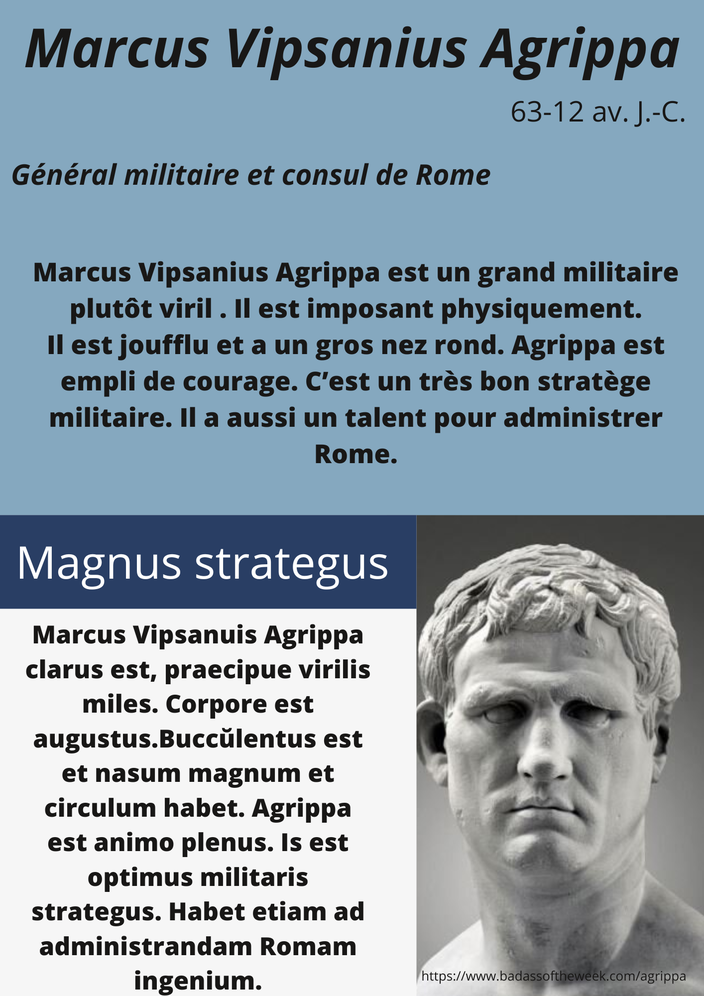2- Méditerranée : voyager, explorer, découvrir
La révolte menée par Zénobie


Séance 11 (cours du 1er décembre) – Rédaction du portrait en salle informatique
Texte à imiter : portrait de Zénobie dans l’Histoire Auguste
Elle avait le visage mat, le teint hâlé, les yeux noirs et d’une vivacité incroyable, l’élégance d’une déesse, une grâce incroyable. Elle avait des dents d’une telle blancheur, qu’on aurait cru voir des perles et non des dents. Sa voix était sonore et virile. On trouvait en elle, quand la nécessité l’exigeait, la sévérité des tyrans ou la clémence des bons princes, lorsque la piété le demandait. Libérale avec prudence, elle savait ménager ses trésors au-delà de ce qu’on peut attendre d’une femme.
Personnalité de l’Antiquité choisie
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Sources utilisées
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Écriture
Composez, en français dans un premier temps, un portrait d’une personne fictive ou réelle construit de la même manière.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Source de l'illustration : nationalgeographic.fr